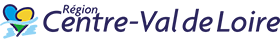Un peu d'histoire
Cahier des doléances, plaintes et remontrances de l'agriculture du Pays Chartrain, dressé par le Tiers Etat et soumis à l'Assemblée du Baillage tenu à Chartres le 2 mars 1789, pour la nomination des députés aux Etats Généraux
Briconville
26 feux - 12 électeurs - 2 députés : Claude Guerin, Sindic de la Municipalité, et Jacques Ricourt, laboureur
Les habitants de Briconville demandent :
- Que tous les étrangers qui prennent à ferme des lots de terre de la paroisse, soient compris au rôle de la taille1 de la dite paroisse, à raison des dits objets nonobstant toute déclaration que les dits étrangers pourroient faire de payer la taille1 dans le lieu de leur domicile, disent les habitants qu'elles sont frauduleuses et frustratoires ;
- Se plaignent : que, pour le recouvrement des deniers royaux et pour en forcer le payement, on ait inventé des espèces de gens qu'on nomme chefs de garnison, qui sont une nouvelle charge pour les peuples qui ne sont déjà que trop accablés d'impôts ;
- Que les dits habitants ne sont accablés d'impôts que parce que les ministres et leur agents, tant que l'administration que dans les financés, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous ces obstacles, et augmenté, jusqu'à l'excès, par l'effet de leur volonté, la charge du peuple dont ils ont dissipé le produit ;
- Qu'aucune partie de leur propriété ne puisse leur être enlevée par des impôts, s'ils n'ont été préalablement consentis par les Etats-Généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, de députés librement élus par tous les cantons sans aucune exception, et chargés de tous pouvoirs ;
- Se plaignent de l'oppression des seigneurs qui accablent leurs vassaux2 par la multiplicité de leurs droits féodaux, comme banalité3, et qui dévastent les campagnes par leur chasse irrégulière, la quantité de gibier de toute espèce dont ils sont infiniment jaloux, et pour le nombre infini de leurs pigeons ; et pour remédier à des abus si craints, supplient les dits habitants Sa Majesté d'obliger les dits seigneurs à faire enclore de murs leurs bois et garennes, faire détruire leurs colombiers et volières, et qu'il ne leur soit permis ni à aucuns roturiers d'en construire ni d'en établir dans la suite ;
- Demande la suppression des justices seigneuriales qui ne servent qu'à multiplier les procès ; en outre la suppression des tabellions et sergents de campagne qui, par leur impéritie, ne font qu'embrouiller les affaires ;
- Se plaignent du brigandage des gens de justice, des procédures vexatoires des procureurs qui ruinent la fortune des citoyens, et dépouillent la veuve et l'orphelin ;
- Demande la suppression des dixmes4 des bénéficiers dont le payement cause un préjudice très-notable à l'agriculture ; demandent en outre l'abolition du droit d'étole, et de tous ces droits odieux pour baptêmes, mariages et sépultures, et que pour doter honnêtement ..................... on supprime tant de communautés qui sont dans la classe des gens inutiles, qu'on diminue ces grandissimes revenus qui ne servent qu'à l'ostentation et à la vanité, tandis qu'ils devroient être le patrimoine des pauvres ;
- Que Sa Majesté tienne la main à ce que l'école de chirurgie examine scrupuleusement les sujets qu'elle envoye dans les campagnes ; qu'on y envoie que les sujets capables et de bonnes mœurs. Car l'expérience ne démontre que trop combien de maux ces gens-là causent par leur ignorance, dans les maladies et les fléaux qui affligent l'humanité ;
- Que Sa Majesté supprime la vénalité des charges5, et qu'elles ne soient données qu'au mérite et à la vertu, afin que cette malheureuse invention ne porte plus le découragement dans l'âme de cette partie des sujets de Sa Majesté la moins fortunée et souvent la plus instruite ;
- Supplient Sa Majesté de jeter un regard favorable sur la plus grande partie de son peuple que l'indigence met dans l'impossibilité d'avoir les choses les plus nécessaires à la vie, à cause des droits exorbitants qui en augmentent le prix, comme sont les entrées, les boissons, le sel, etc...
(Annuaire du département d'Eure-et-Loir - 1848 - n°9 - pages 270-271)
1 taille : la taille est un impôt direct de l'Ancien Régime français. Il devient annuel et permanent en 1439 lors de la guerre de Cent Ans.
- Le 2 novembre 1439, les Etats généraux, réunis depuis octobre à Orléans, décident l'entretien d'une armée permanente pour pouvoir bouter définitivement les Anglais hors de France. Cette décision déclenche une révolte des nobles : la Praguerie (1440). Pour financer l'effort de guerre les états généraux instituent un nouvel impôt, qui sera prélevé dans chaque famille du royaume : la "taille". Les délégués accordent à Charles VII la permission de relever la taille tous les ans. Ce nouvel impôt annuel ne sera aboli qu'à la Révolution.
- A l'origine, le terme désigne une baguette de bois fendue, permettant de conserver la trace de valeurs chiffrées. C'est un système de comptabilité accessible aux personnes ne sachant pas lire et écrire. Il est employé d'abord pour les paiements à crédit, puis est appliqué à la fiscalité.
- La taille seigneuriale apparaît dans la deuxième moitié du XIe siècle. Elle a pour but de faire contribuer les communautés villageoises aux charges de la seigneurie, en compensation de la protection accordée par le seigneur. Très vite cependant elle perd toute justification, ce qui déclenche nombre de différends entre les seigneurs et les redevables de la taille.
- La taille royale peut prendre deux formes : taille personnelle (dans la plupart des pays d'élection), elle concerne les chefs de familles roturiers, répartie par les collecteurs, selon les facultés. C'est la formule la plus courante ; taille réelle (dans la plupart des pays d'état), elle concerne les biens. Un noble sera taxé sur ses biens roturiers, tandis qu'un roturier en sera exempté sur ses biens nobles.
- L'imposition se base sur le feu, c'est-à-dire l'âtre autour duquel sont rassemblé le chef de famille et ses enfants. Seul le nom du chef de famille est indiqué dans les registres. Son montant est fixé arbitrairement en fonction des besoins seigneuriaux et des capacités de la population.
- Le recouvrement est perçu par des hommes désignés dans la population de la paroisse. Ces personnes sont responsables sur leurs biens.
- De nombreuses villes sont franches, comme Dieppe dès 1463. La Bretagne est entièrement libre de taille. Il s'agit en général de privilèges locaux qui ne sont pas révocables par le roi.
- La taille sous Henri IV représente environ 60% des ressources du royaume, à la fin du règne de Louis XIV 25 %. L'état se finance alors beaucoup par emprunts et impôts indirects.
- La taille réelle assise sur la terre et la taille personnelle frappaient les revenus. Dans les pays d'état, c'étaient les états qui répartissaient la taille entre les paroisses de la province ; dans les pays d'élection, c'était l'intendant. La taille, répartie entre les contribuables en fonction de leurs revenus présumés, était perçue par des collecteurs nommés par l'assemblée des paysans. Pour assurer la rentrée de l'impôt, tous les habitants aisés d'un village étaient solidaires vis-à-vis du Trésor. La capitation, instituée en 1695, était payée par tête.
2 vassalité : héritière de la recommandation du Haut Moyen âge, la vassalité est la situation de dépendance d'un homme libre (vassal, du latin vassus) envers son seigneur par la cérémonie de l'hommage. Le système féodo-vassalique s'est développé à cause de l'affaiblissement de l'autorité publique après l'effondrement de l'empire carolingien (Xe-XIe siècle) : l'empereur, les rois et bientôt les princes territoriaux étaient incapables de faire régner l'ordre et d'imposer leur pouvoir aux seigneurs locaux. Un réseau de relations d'homme à homme s'impose donc, donnant des droits et des devoirs pour chacun d'entre eux, une pyramide sociale allant théoriquement du roi au grand seigneur (grand feudataire), seigneur, vassal et arrière-vassal (vavasseur) mais dont l'effectivité dépend de l'autorité du supérieur.
- Des obligations réciproques :
- Même si la vassalité allie deux hommes libres, il est cependant évident que ces hommes ne sont pas égaux : le seigneur a davantage de pouvoir que le vassal. En effet, il dispose du droit de ban, c'est-à-dire le droit de punir, contraindre et juger. Le vassal se met sous la protection d'un plus puissant. Néanmoins cette puissance doit beaucoup au nombre, à la loyauté et la puissance relative de ses vassaux, d'où la réciprocité. On parle donc de contrat synallagmatique car il engage les deux parties à l'acte qui ont des obligations l'une envers l'autre.
- Les devoirs du vassal envers son seigneur :
- Le contrat peut se résumer à l'auxilium, c'est-à-dire l'aide, et au consilium, le conseil (et non "concilium").
- Les devoirs du vassal envers son seigneur sont d'abord des interdictions : le vassal ne doit pas nuire à son seigneur, à sa famille et à ses biens. Obligations somme toute assez vagues.
- Le vassal doit l'aide militaire à son seigneur : lorsque celui-ci est attaqué, le vassal doit venir avec ses armes pour le défendre. Le vassal est aussi chargé de la garde du château (estage) et de l'escorte de son seigneur. Quand le seigneur attaque un autre, le service militaire (ost) ou (host) est limité à 40 jours. Mais le vassal reste évidemment aux côtés de son seigneur si le conflit dépasse cette durée. Il sera dédommagé en argent au-delà de 40 jours de combat.
- Le vassal doit aussi assurer une aide financière : l'aide aux 4 cas (en France et Angleterre) ; le vassal doit donner de l'argent ou des cadeaux à son seigneur lorsqu'il marie sa fille aînée, lorsqu'il adoube son fils aîné, lorsqu'il part à la croisade et lorsqu'il est fait prisonnier et qu'il doit une rançon.
- Enfin, le vassal est astreint à fournir des conseils à la demande de son seigneur : il doit participer aux assemblées féodales, aux cours de justice du seigneur ainsi qu'aux fêtes liturgiques. L'ensemble des vassaux d'un seigneur est ainsi soudé par ces temps forts.
- Les devoirs du seigneur envers son vassal :
- Les dépenses du vassal sont donc considérables : il doit acheter et entretenir un cheval et des armes ; il doit pouvoir se nourrir et assurer un certain genre de vie. C'est pour répondre à ces exigences que le seigneur doit donner un fief à son vassal. Ce fief est en général une terre qui rapporte des revenus au vassal (redevances). Le fief est pris sur les terres ou les revenus du seigneur.
- Le seigneur doit également protéger son vassal contre ses ennemis et lui rendre bonne justice.
3 banalité : les banalités sont, dans le système féodal, des installations techniques que le seigneur est dans l'obligation d'entretenir et mettre à disposition de tout habitant de la seigneurie. La contrepartie en est que les habitants de cette seigneurie ne peuvent utiliser que ces installations seigneuriales, payantes. Ce sont donc des monopoles technologiques.
- Les principales banalités sont : le four, le moulin, le pressoir, le marché aux vins, etc...
- Un autre droit seigneurial était la banalité de tor et ver, donnant au seigneur seul le droit de posséder un taureau ou un verrat. Ainsi la reproduction du bétail pouvait aussi être sujette à redevance.
- Ces privilèges, théoriquement abolis le 5 aout 1789, ne le seront effectivement qu'en 1793.
4 dîme : la dîme (du latin decima, dixième) était, sous l'Ancien Régime en France, un impôt collecté en faveur de l'Eglise catholique et servant à l'entretien des ministres du culte.
- L'idée d'un impôt pour l'entretien du clergé se trouve dans la Bible (Genèse, XIV-20 et XXVIII-22). Chez les Juifs, c'est la dixième partie de la récolte prélevée pour l'entretien des Lévites et sur tous les revenus pour organiser un festin pour toute la maisonnée.
- Dans le monde chrétien, la dîme est d'abord une pratique religieuse qui devient obligatoire au IVe siècle. Les capitulaires de 779 et 794, la rendent exigible de toute la population, y compris sur les biens personnels des membres du clergé, dans tout l'Empire franc.
- Elle correspondait à une certaine part de la récolte (la part variant d'un évêché à l'autre et même d'une paroisse à l'autre, voire parfois à l'intérieur d'une même paroisse. Le taux était élevé dans le Sud-ouest de la France (jusqu'au huitième), en Lorraine (jusqu'au septième). Il était du onzième en Normandie, du treizième dans le Berry, du cinquantième en Flandre maritime, presque aussi faible en Dauphiné et en Provence.
- Afin de procéder à la collecte de cet impôt, le curé primitif passait par un fermier, soit pour la totalité de la dîme, soit pour une partie (moitié, tiers, quart, sixième, etc...) et en général pour une durée de six ou sept ans selon les régions.
- La dîme était l'impôt perçu avant tous les autres. Le fermier, la conservait moyennant une redevance annuelle versée soit en nature, soit en monnaie, au décimateur, c'est-à-dire le curé primitif. Le curé desservant recevait alors du "curé primitif" la portion congrue. La dîme sur les céréales mécontentait les paysans privés de la paille nécessaire à la litière et à la fumure. L'accaparement de la dîme par les gros décimateurs qui en détournaient l'utilisation originelle (entretien des églises, du clergé desservant, assistance aux pauvres, création des écoles, etc...) créait aussi un malaise. Loin d'en demander la disparition, les fidèles réclamaient une meilleure utilisation. La dîme fut supprimée avec les privilèges le 4 août 1789. La Constitution civile du clergé de 1790 créa un clergé salarié par l'Etat.
- On pouvait distinguer, selon les régions et les périodes, différents types de dîmes : dîme grosse : porte sur les gros grains, froment et seigle ; dîme inféodée : dîme sécularisée perçue par un laïc ; dîme menue : porte sur les bestiaux (également appelée "carnelage") et la laine ; dîme mixte : porte sur les animaux ; dîme novale : porte sur des terres défrichées depuis moins de 40 ans ; dîme personnelle : porte sur le fruit du travail ; dîme solite : perçue depuis des temps immémoriaux (les dîmes insolites étant occasionnelles) ; dîme réelle ou prédiale : porte sur les fruits de la terre ; dîme verte : porte sur le lin, le chanvre, les fruits et le légumes.
- En 1789, les estimations de l'époque évaluent le montant de la dîme entre 70 et 130 millions de livres.
5 vénalité : la vénalité désigne le caractère de ce qui est vénal, c'est-à-dire ce qui peut être vendu ; le mot et l'adjectif s'appliquent aussi bien à des actions qu'à des individus. On qualifie les prostituées de "femmes vénales", car elles font commerce de leur corps, elles se vendent.
- La vénalité des charges ou des offices désigne un système, dans lequel les fonctions et charges sont attribuées comme un bien monnayable : en d'autres termes, la personne désirant occuper une charge doit s'acquitter pour cela d'une certaine somme d'argent.
- Ce système s'oppose à d'autres systèmes d'attribution des charges, notamment au mérite (diplôme, expérience, formations reconnues), à l'ancienneté, etc...
- En France, la vénalité des offices, qui concernait nombre de hautes fonctions de notables, a été fortement remis en cause dans la période précédant directement la Révolution de 1789.
- à noter qu'en France, aujourd'hui encore, la charge de notaire s'achète.
(Source : Wikipédia)